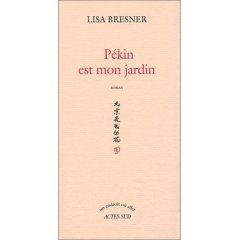Mamée, à nouveau, premières lignes réécrites cet été...
A VOTRE TOUR, VOUS VOUS LEVEZ. Aux frôlements des semelles sur le sol en terre cuite, à la vue qui s’obscurcit soudain d’étoffes, à l’air brassé sur votre visage. Une demi seconde en retard. C’est un mécanisme bien huilé, ouvert aux seuls initiés : savoir quand se lever, quand s’asseoir, à quel mot, quelle prière, quel silence. Vos compagnons de banc ont la même désynchronisation que vous, une demi seconde de retard. Debout, le même regard aussi. Vide, hagard, ancré sur un coffret en chêne.
Dehors, les premières gouttes sur le vitrail. Tambourine, tambourine, tambourine puis crépite. A la lueur d’un éclair, des ruisseaux de couleurs débordent de leurs baguettes de plomb. Dehors. Ca doit sentir bon dehors. Le mouillé sur le sec. Ca sentait pareil le premier soir avec elle, sous les chênes verts qui s’égouttaient. Avec ce même goût de la douleur dans la bouche. Sauf qu’aujourd’hui elle se niche dans votre nuque. Comme une barre.
Presque immédiatement, aux salves des applaudissements, ça vous avait saisi tout votre plaisir. Aucun signe avant coureur, comme à chaque fois. Pas une irruption non plus, d’une douleur nette, fulgurante. Juste un accroc. Une maille qui saute, dans le bas du dos. Et toujours à la même période, les prémisses de l’été. 21 juin, premier jour de l’été, fête de la musique. Pouviez pas mieux faire cette année. Ce n’était qu’un tiraillement, mais bientôt vous le saviez, la colonne allait se courber, de l’échine au sacrum, vous imposez son poids, vous soumettre à sa volonté de cheville du corps.
La douleur d’aujourd’hui, c’est presque un baume à côté. Elle vous serre la nuque comme un étau, retient vos larmes au chaud, amères, bileuses. Vous vous y vautrez, vous y complaisez, vous y endormez. Vous l’avez reconnu, c’est l’écharpe du deuil, votre écharpe que vous pensiez remisée depuis trois ans dans une vieille armoire de famille. Elle s’enroule autour de votre cou, aussi sournoise qu’alors. Qui vous réchauffe, qui vous maintient la nuque aujourd’hui, mais dont le nœud trop serré vous comprimera bientôt la glotte. Et dans ses fibres, l’odeur des deuils passés et à venir.
Celle de ce soir de juin vous avait anéantit, coupé dans votre élan. Votre dos venait de se verrouiller, comme à chaque fois sans prévenir, et cette fois-ci au pire moment, à l’apogée de votre plaisir. Et tout alors, très vite, était devenu vain, insipide. Ce concert que vous veniez d’improviser, le mariage des cordes pincées, grattées et du martèlement de Patrice, l’alchimie de l’eau et du feu, les yeux brillants de Thom, les joues écarlates de Bertrand, et cette foule surtout, dense, à la fois sombre et luisante dans l’antre de Patrice, qui s’étirait en corne d’abondance jusque sous sa pergola en fer forgé. Cette foule, ce bain d’énergie qui vous avait porté, électrifié tout au long de cette étrange soirée, cette foule que vous ne pensiez plus qu’à couper pour vous en écarter, vous en isoler. Traverser la foule, la route, emmêler la douleur à l’obscurité, là bas, tout là bas, dans la masse sombre du parc. Vous avez posé votre contrebasse contre le mur de la forge, tenté de faire un signe à Bertrand, mais difficile de mimer la souffrance dans l’euphorie. Et vous vous y êtes jeté, le corps plié, la douleur qui vous cisaillait déjà les reins. Des mains moites s’abattaient sur vos épaules, vous secouaient avec effusion, accentuaient les décharges électriques le long de votre colonne. Les potes habituels, les groupies. Des inconnus aussi. Et ce journaliste du Ouest dont vous parlerait Bertrand le lendemain, un type complètement excité, aux dithyrambes alcoolisés dont vous aviez eu le plus grand mal à vous débarrasser.
Aujourd’hui, deux mois jour pour jour. Deux mois seulement que vous la connaissiez. Aujourd’hui, il n’y a pas de journalistes dans l’église d’Asnières. Personne ne s’est déplacé pour une pauvre vieille de plus ou de moins dans cette hécatombe caniculaire. La une sera à l’orage, tous les regards doivent être braqués vers le ciel. Vaseux, poisseux tout à l’heure tandis que vous fumiez votre dernière cigarette sur le parvis. Noir, opaque à présent, de ce que vous pouvez en voir en tout cas, depuis votre banc, déformé par le prisme du vitrail aux couleurs soudain ternes. Ce ciel qui vient enfin d’ouvrir les vannes à une eau trop longtemps contenue. Vous devriez sortir vous aussi, vous décoller de ce banc en bois, fuir la voix monocorde du curé qui fluctue à présent, un ton en dessus, un ton en dessous, au gré du cliquetis, au gré du battement de la pluie sur le vitrail, dont les cordes vocales adeptes du ronronnement menacent soudain de rompre, à trop s’étirer, de l’aigu au grave, du chaud au froid. Vous devriez sortir oui, passer devant le chat noir, vous faufiler par la lourde porte, aller danser sur le parvis de l’église, sauter sur les bancs en pierre, vous allonger sur le sol pour entendre croustiller la terre. Ce serait la meilleure façon de lui rendre hommage, à votre aqueuse qui s’en est allée, lassée de l’attendre. La meilleure façon de lui rendre hommage, plutôt que de deviner son corps, là, à quelques mètres de vous, s’asséchant déjà dans son coffret en chêne.
Les chênes verts ce soir là, ceux du Jardin Public, c’était la première fois que vous les voyiez vraiment. Il vous aura fallu la nuit, à les deviner de leurs masses sombres et mouvantes derrière vous, pour en prendre vraiment conscience. Vous aviez réussi à vous extraire du banc humain et manqué de vous affaler sur l’asphalte mouillé quand la foule ne vous avait plus portée. Vous vous étiez rattrapé de justesse aux grilles du parc qui s’étaient ouvertes sous le choc. Devaient pas les fermer la nuit, ça vous a surpris. Vous vous êtes jeté sur le premier banc, un peu plus haut. Vous aviez les fesses au frais, la pluie venait enfin de s’arrêter, ça vous remontait dans le bas du dos comme un cataplasme. Le goût de douleur dans la bouche, à essayer de le faire passer à grosse goulée d’air. Acre comme la terre mouillée. Ca passait, doucement, avec le bruissement des chênes verts et la stridulation des grillons qui apaisaient vos tympans. La nuit épaisse sur vos yeux …Et les flammes de la forge en filigrane.
Le ciel craque plus fort derrière vous, vous vous tournez discrètement, le temps de l’apercevoir s’engouffrer rapidement par la lourde porte en chêne qu’elle repousse aussitôt derrière elle. Les grondements du ciel, estompés à nouveau, derrière, dehors, tandis qu’elle passe furtivement devant le chat noir pelotonné sur la chaise basse, en biais près de l’entrée. Qui n’a même pas frémi, ni daigné ouvrir un œil, en vieil habitué des lieux, comme une ombre de plus que ne régit aucun principe de lumière. Elle s’assoit, discrète, deux rangs derrière vous, puis se relève soudain, réalisant. Par imitation, comme vous. Faisant bouger l’air et apporter jusqu’à vous l’odeur poignante de terre mouillée qui s’est nichée dans ses cheveux, dans les fibres de ses vêtements où perlent des gouttes de pluie.
Comme ce soir-là sur les vêtements, les lunettes, les billes arrondies des gamins devant les flammèches, les scoubidous de feu de Patrice. Fallait voir les yeux des gamins. Oh, pas que des gamins d’ailleurs… C’est pas tous les jours qu’on investit une forge, surtout un soir de Fête de la musique. Ce que vous n’aviez pas prévu, c’étaient les travaux en cours sur la rocade qui entraveraient l’accès au centre ville et qui allaient faire refluer pas mal de voitures vers le terrain vague près de la piscine, en aval de la forge. Et puis surtout le coup de pouce de la météo avec l’orage et la pluie, donc, l’orage et la pluie, déjà, qui s’abattraient au beau milieu de la soirée. Ca vous avait ramené un paquet de monde sur le retour. Et Patrice, imperturbable. Qui continuait d’égrener le temps à coup de marteau sur l’enclume, tandis que son repère n’en finissait pas d’avaler le flot des passants qui s’ébrouaient devant ses étincelles. Vous, vous trois, ça vous avait un peu affolé au début, tout ce public d’un coup. Dense, bruyant, et toutes ces gouttes, à la lumière du foyer, qui perlaient sur les vêtements, les lunettes, comme une myriade de briquets allumés un soir de grand concert. Un grand concert improvisé oui, avec trois fois rien, votre maigre répertoire de musicos débutants, votre curieuse salle de répétition, l’annexe de la forge de Patrice, votre repère caché, tout recroquevillé dans son ombre et sa lumière, dans son bruit et ses silences, découvert, assiégé soudain par une foule qui s’improvise au coude à coude, soudée, complice et vivifiée par les trombes d’eau qu’elle vient de se prendre sur le tête. Une foule mouillée, bariolée de générations mêlées, pas fâchées de trouver un endroit au sec, un endroit au chaud, le refuge du dernier espoir dans cette fête gâchée, l’ultime saut de puce avant le parking, avant le come back annoncé vers la télécommande, par défaut, par dépit.
Vous sentez un regard qui appuie sur votre douleur, s’y attarde, s’y installe. C’est comme un frisson qui court sur vos omoplates. A nouveau, vous tournez doucement la tête et le cueillez deux rangs derrière vous. Deux yeux qui scrutent l’obscurité croissante de l’église, qui sondent la maigre assemblée, s’égarent vers les fresques murales ocres rouges puis plongent dans les votre. Deux yeux las, éteints, qui s’enfièvrent lorsque vous les accostez.
Les flammèches de Patrice, en filigrane dans la nuit épaisse du parc, dans votre solitude recherchée, provoquée, incohérente et votre dépit que vous égrenez depuis votre banc sur les rires et les cris qui saluent votre succès d’un soir, sur la foule, en bas, qui peu à peu s’éparpille et s’éloigne de la forge, sur une ombre, soudain, dans le parc, plus bas, près de la grille entrouverte. Une ombre qui sautille de flaque en flaque et qui grimpe vers votre banc. Mamée.
Deux mois jour pour jour, deux mois seulement. Elle entrait dans votre vie, en bottes en caoutchouc, ciré et chapeau de pluie. Petite ombre d’enfant rebelle ayant échappée à la vigilance de ses parents un soir de fête, trop heureuse de s’engouffrer par la porte entrouverte du parc. Et vous, crispé, tendu par l’effort de vous mettre debout, irrité, déjà prêt à l’intercepter sans ménagement pour lui ordonner de faire demi tour, tombant nez à nez, à deux pas de votre banc, luisant, à peine éclairé, avec une petite vieille toute ridée du sourire qui lui barre le visage. Les yeux écarquillés. Pas par la surprise de vous trouver là, en pleine nuit dans un parc censé être fermé. Non. Complètement absorbée par la tâche qui l’anime depuis le bas de l’allée : sauter de flaque en flaque.
Deux yeux qui s’enfièvrent lorsque vous les accostez, deux yeux qui vous troublent comme leur voix, deux jours plus tôt. Elle est venue, finalement, elle est bien venue. Deux yeux, deux rangs derrière vous. C’est tout ce qui vous reste de Mamée.
Les dos s’affaissent. A votre tour, vous vous asseyez.